
L'attestation télétravail de l'assurance habitation
Découvrez tout sur l’attestation télétravail de l’assurance habitation, à quoi elle sert et comment l’obtenir.
Par Luko by Allianz Direct
Explorez de manière détaillée les concepts d'opposabilité et d'inopposabilité d'un tiers dans le contexte de l'assurance responsabilité civile.

En droit des obligations, un tiers désigne toute personne qui n’est pas partie prenante au contrat. Autrement dit, il n’a pas signé le contrat ou été représenté par un mandataire le jour de sa signature. C’est donc quelqu’un qui n’a en théorie, rien à voir avec le contrat. Il faut bien préciser, « en théorie » car nous allons voir que dans les faits, et en particulier en droit des assurances, le tiers peut se voir opposer le contrat, c’est-à-dire qu’il peut devenir concerné par les termes qu’il contient, en cas de sinistre notamment.
Vous souhaitez recevoir nos conseils et bons plans ?
Inscrivez vous à notre newsletter pour recevoir le meilleur de Luko dans votre boîte mail.
Nous l’avons vu ci-dessus, selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne produit d’effet qu’entre les parties contractantes et non à l’égard des tiers. C’est ce que l'on nomme le principe de l’effet relatif du contrat.
En principe donc, le contrat n'engage que les parties contractantes. On dit alors que le contrat n'est pas opposable aux tiers : on ne peut l’obliger à respecter les termes d’un document dont il n’a pas connaissance et qu’il n’a pas signé. On parle ici d’inopposabilité aux tiers.
Il existe toutefois plusieurs exceptions où le tiers peut se voir opposer le contenu du contrat : soit être contraint de le respecter même s’il n’a pas signé. C’est le cas notamment lorsque le contrat a été rendu public, comme un brevet ou la propriété intellectuelle. Celui qui possède un brevet ou un droit de propriété intellectuelle peut interdire aux autres de réutiliser son invention ou son écrit. Ce droit est alors opposable aux tiers parce qu'il est publié.
En droit des assurances, nous avons généralement deux parties prenantes, l’assureur et l’assuré. Cependant, lors de la survenance d’un sinistre, il se peut que la victime ne soit pas l’assuré, mais un voisin, un passant dans la rue ou toute autre personne étrangère au contrat, mais victime du sinistre dont vous êtes à l’origine (dégât des eaux, accident de voiture, etc). Votre contrat d’assurance vous couvre justement pour indemniser à votre place les tiers lésés par votre faute. Votre contrat d’assurance leur devient donc opposable puisqu’ils deviennent concernés par les garanties que vous avez souscrites.
En cas de sinistre, le tiers lésé peut contacter votre assureur directement, plutôt que de vous demander de jouer les intermédiaires. C’est ce qu’on appelle exercer une action directe. Lors de sa requête pour une indemnisation, il se verra opposer par l’assureur les limites et plafonds de garanties auxquelles vous avez souscrit. Il ne pourra pas avoir plus que les garanties de votre contrat.
Les franchises lui seront également appliquées. On dit que les exceptions de garantie sont opposables au tiers lésé qui exerce l'action directe. Attention toutefois, une clause d’un contrat d’assurance ne sera opposable que si elle a été portée à la connaissance de l’assuré. Si l’assureur n’a pas informé l’assuré d’une modification de clause ou de garantie, elle ne pourra être opposée à l’assuré ou au tiers lésé en cas de sinistre.
Par exemple, si vous avez souscrit une garantie allant jusqu’à 5 000€ pour un dégât des eaux, si le voisin en demande 7 000€, l’assureur ne pourra déroger à la limite des 5 000€. Le principe est le même pour les exceptions de garantie. Si vous avez refusé de souscrire une garantie visant à rembourser les frais d’expertise, et que votre voisin adresse à votre assureur une facture d’expert, celui-ci peut refuser de prendre en charge les honoraires sous couvert d’exception de garantie.
Bien entendu, si l’une ou l’autre des parties a résilié le contrat d’assurance et qu’un sinistre causant préjudice à un tiers survient, aucune action directe ne pourra être exercé contre l’ancien assureur puisque plus aucun contrat ne le lie au responsable du sinistre.
L’article L. 113-8 du Code des assurances relatif aux fausses déclarations intentionnelles énonce que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré. Autrement dit, le contrat d’assurance peut être déclaré nul en cas de fausse déclaration ou si l’assuré a volontairement omis de déclarer un changement de risque. Dans ce cas, le contrat est réputé n’avoir jamais existé et l’assuré ne peut obtenir d’indemnisation, au titre de ce contrat, en cas de sinistre.
Et que se passe-t-il dans le cas où un tiers lésé exerce une action directe pour obtenir indemnisation ? Il ‘s’avère que la nullité est opposable à tout bénéficiaire. Sauf dans des cas particuliers, les victimes ne peuvent donc généralement pas réclamer l’indemnisation des préjudices auprès de l’assureur.
Une exception cependant a été introduite par la jurisprudence puis repris dans le nouvel article L.211-7-1 du Code des assurances, Instauré par la loi Pacte du 22 mai 2019, il souligne que la nullité d’un contrat d’assurance n’est pas opposable aux victimes pour les dommages subis lors d’un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule terrestre à moteur. L’assureur qui couvre la responsabilité civile de son assuré responsable est tenu d’indemniser les victimes de l’accident de circulation. Cela signifie donc que la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles telle que prévue par l’article L. 113-8 du Code des assurances n’est pas opposable aux tierces victimes d’un accident de la route et à leurs ayants droit.
La règle proportionnelle de prime intervient lorsque l’assureur réalise, lors de la survenance d’un sinistre, que le risque souscrit ne correspond pas au risque réel (par exemple, l’assuré a déclaré 4 pièces au lieu de 5) mais qu’il n’y avait pas de mauvaise intention de la part de l’assuré. Dans ce cas, lorsque le sinistre survient, l’assureur vient diminuer le montant de l’indemnité pour compenser le surplus de primes qu’il aurait dû recevoir si le vrai risque avait été connu. La réduction proportionnelle est opposable à tous les bénéficiaires du contrat d’assurance, y compris les tierces victimes, sauf exception prévue par la loi (victimes d’accident de la circulation).
La déchéance de garantie est une décision prise par l'assureur qui consiste en la privation du droit pour l'assuré à être indemnisé en raison d'une ou plusieurs fautes par rapport aux obligations contractuelles (non-paiement des primes, conduite en état d’ivresse, non-déclaration du sinistre dans les délais prévus, etc). Cette suspension de garantie est provisoire et concerne le sinistre qui vient d’avoir lieu. La déchéance de garanties n'est donc pas opposable aux tiers. Si des tiers sont victimes du sinistre qui fait l'objet d’une déchéance de garantie, ils seront tout de même indemnisés par l'assureur. En revanche, l’assureur se retournera contre l'assuré qui devra le rembourser intégralement.
La principale façon de rendre un acte opposable est de lui donner de la publicité. Ainsi nul ne peut ignorer son existence et il s’impose donc à tous, même les non signataires. Un acte opposable est un document juridique que tout le monde doit respecter, même les personnes qui ne l’ont pas signé. C’est par exemple le cas d’un droit de propriété qui empêche toute personne de pénétrer sur une propriété privée ou de s’en emparer.
Pour qu'un contrat devienne opposable aux tiers, il faut en faire la publicité. C'est notamment le cas de la publication d'un brevet d'invention ou d'une cession de parts sociales.
Il s’agit d’un droit que le citoyen peut opposer à une entité ou à une administration qui est chargée de le faire respecter. C’est par exemple le cas du droit à la scolarité, à la protection de la santé ou au logement.
Dans cette situation le détenteur du droit a la possibilité d’obliger les tiers à le respecter. Cela s’effectue seulement dans le cas où le contrat a un effet à leur égard. Par exemple le droit de la propriété intellectuelle doit être respecté par tous, même par ceux qui n’ont pas signé le contrat.
Quand un contrat est opposable aux tiers, une personne extérieure au contrat peut se retourner contre l'un des contractants. Dans le cas où l'une des obligations n'a pas été remplie et que cela cause un préjudice au tiers.
Il s’agit de la personne victime des dommages dont l’assuré est responsable. Le tiers est généralement extérieur à la famille et aux proches de l’assuré. Par exemple, un associé d’entreprise ou un employé de maison n’est pas considéré comme un tiers pour l’assureur.
















Articles liés

L'attestation télétravail de l'assurance habitation
Découvrez tout sur l’attestation télétravail de l’assurance habitation, à quoi elle sert et comment l’obtenir.
Par Luko by Allianz Direct
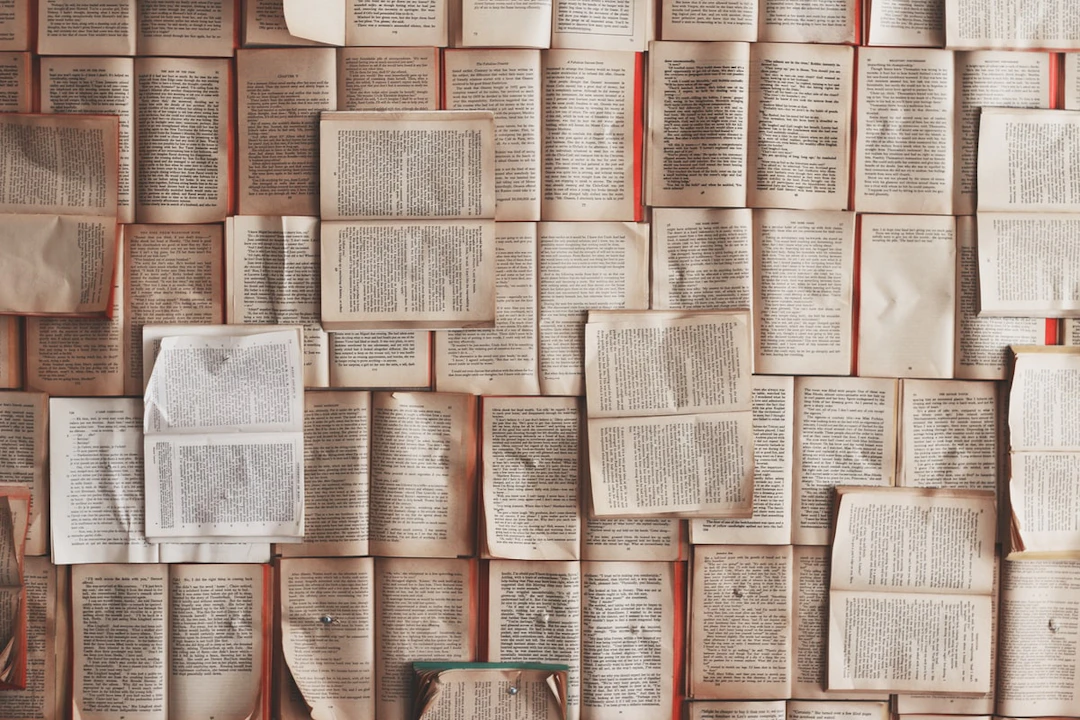
La franchise du contrat d'assurance
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la franchise du contrat d'assurance
Par Luko by Allianz Direct

Est-ce que votre enfant peut changer d'école en cours d'année ?
Vous avez des enfants scolarisés de la petite école au lycée ? Pour une raison ou une autre, vous voulez qu'ils changent d'école en cours d'année ? Contrairement aux idées reçues, c'est un process délicat, voire très complexe. On vous donne plus de clés dans cet article.
Par Luko by Allianz Direct

Vidéosurveillance : la législation pour les particuliers
En France, la loi encadre l’installation des caméras de surveillance chez le particulier qui doit être fait dans le respect de la vie privée.
Par Luko by Allianz Direct

Repeindre ses murs en location : les règles à respecter
Vous voulez repeindre les murs de votre logement en location ? Zoom sur les règles à respecter !
Par Luko by Allianz Direct

Qu'est-ce qu'une résidence secondaire pour les impôts ?
Tout savoir sur la résidence secondaire pour les impôts.
Par Luko by Allianz Direct